
Le Check-up : Transformer l’Innovation en Succès dans le Secteur Santé
15 avril 2025
Voir plus

08 juillet 2024
Atteindre une croissance solide et pérenne sans diluer votre capital ? C’est possible avec le financement non-dilutif !
Voir plus
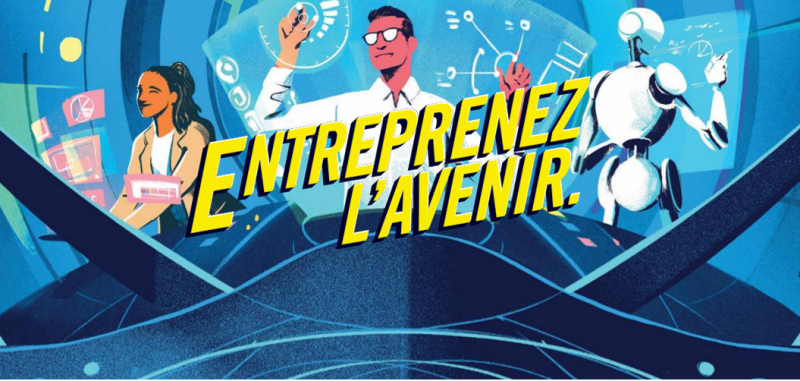
In extenso leader de l’expertise comptable, du conseil et des services dédiés à tous ceux qui entreprennent l’avenir
22 mars 2024
Voir plus

Enedis franchit une étape décisive dans la lutte contre le harcèlement sexuel et sexiste
21 février 2024
Enedis est engagée depuis 2020 dans une politique de tolérance zéro en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes. L’entreprise a souhaité renouveler ses pratiques en s’appuyant sur l’innovation et lance en 2021 un concours Start-Up avec une catégorie « révolution de la confiance ».
Voir plus

Patte Blanche Atelier : engagée pour votre élégance, en toute simplicité !
21 novembre 2023
Nous sommes Romain Fays et Théo Egéa, fondateurs de Patte Blanche Atelier, mais avant tout, deux amis engagés pour la planète. Avec détermination et humilité, nous avons décidé de prendre notre envol en 2021 pour lancer une marque réellement éthique, en accord avec nos valeurs…
Voir plus

FIDAL AVOCATS « Rhône Alpes » lance son offre « full service » dédiée aux start-up et porteurs de projets
14 novembre 2023
Fort d’une équipe d’avocats dédiés et aguerries aux start-up depuis plusieurs années sur l’ensemble des domaines du droit des affaires (Droit des sociétés, levée de fonds, propriété intellectuelle, droit des contrats, digital et data, droit social, droit fiscal, financement), FIDAL propose un accompagnement sur-mesure à…
Voir plus

L’Industrie 4.0 au service de l’efficience des opérations
19 avril 2022
Comment les technologies de l’Industrie 4.0 peuvent aider nos industries à renforcer leur capacité de résilience dans un contexte où l’instabilité est devenue la norme ? Mercredi 6 avril 2022, Sopra Steria Next, Le Village by CA Centre-Est, SWARM et France Supply Chain se sont…
Voir plus

Parole d’expert : Rencontre avec Lydia Delbosco
17 janvier 2022
Lydia Delbosco, vous dirigez un cabinet de conseil en management et transformation des entreprises avec des approches innovantes mobilisant plus particulièrement l’intelligence collective. Quelles clés pourriez-vous partager avec nos lecteurs en ce début d’année, notamment dans le contexte de changement avec les nouvelles modalités de…
Voir plus

4ème Edition Village Awards
30 juin 2021
Lancement de l’appel à candidatures dans toute la France Les Villages Awards récompensent les meilleures coopérations de l’année entre startups et grands groupes/ETI lors d’une grande soirée le 30 septembre 2021 au Village by CA Paris. Cet appel à candidatures…
Voir plus

partenariat Sodexo – Le Village by CA Centre-est
26 janvier 2021
Renouvellement du partenariat Sodexo – Le Village by CA Centre-est pour trois ans. Le partenariat Sodexo – Le Village by CA Centre-est ne date pas d’aujourd’hui. Sodexo est l’un des partenaires de la première heure du Village by CA Centre-est lors de sa création en…
Voir plus

partenariat CNR – Le Village by CA Centre-est
20 novembre 2020
Renouvellement du partenariat CNR – Le Village by CA Centre-est pour trois ans. Le partenariat CNR – Le Village by CA Centre-est ne date pas d’aujourd’hui. CNR est l’un des partenaires de la première heure du Village by CA Centre-est lors de sa création en…
Voir plus
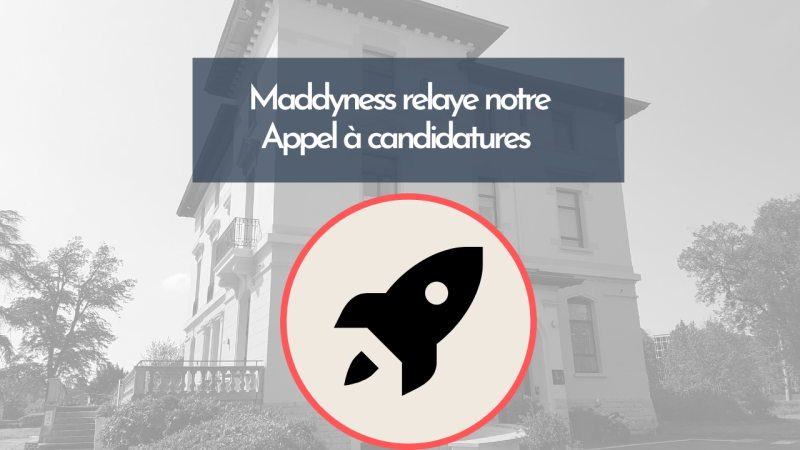
Maddyness relaye notre appel à candidature et les 9 raisons d’intégrer le Village
19 octobre 2020
Maddyness relaye notre appel à candidatures Merci à Maddyness pour cette belle mise en lumière de notre structure et de notre programme d’accompagnement. Nous sommes ravie d’avoir pu paraitre dans l’agenda de ce magazine spécialisé start-up et réputé pour son expertise dans le domaine de…
Voir plus
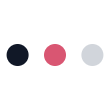

 fr
fr